Avant octobre 2001, pas de doute : on pensait l’obligation de la garde inhérente à la pratique du généraliste. Et voilà qu’à quelques mois de l’élection présidentielle, un grand mouvement de grève se répand pour réclamer le volontariat de la garde. La mobilisation part de la base et notamment de Champagne-Ardennes.
Jean-Paul Hamon comme Luc Duquesnel n’ont pas encore à l’époque de responsabilités nationales mais bataillent fermes en région, témoins privilégiés de cette jacquerie. « En Champagne-Ardennes, les médecins voulaient en fait être rémunérés davantage, du coup ils avaient mis en place un système où il se faisait appeler par le 15 », se souvient Jean-Paul Hamon. En Mayenne, également un des premiers départements à s’être mis en action, Luc Duquesnel reconnaît que l’ampleur du mouvement dès le départ a pu surprendre. «
Un préavis de grève a été déposé le 15 octobre et on ne s’attendait pas à voir le 15 novembre l’ensemble des médecins en grève dans le département ».
Démonstration est faite d’un immense ras-le-bol des généralistes qui dans certaines régions ne supportent plus de se retrouver de garde nuit et jour. Ici et là, se pose alors la question du bien-fondé de la PDS telle qu’elle est organisée à l’époque. « Bien souvent, les médecins recevaient quinze appels par nuit dont seulement trois ou quatre qui nécessitaient une consultation médicale, ce qui ne veut pas dire une urgence », rappelle Jean-Paul Hamon. L’ampleur du mouvement prend un peu par surprise syndicats et institutions. Et sera à l’origine d’une crise sévère au sein du Conseil national de l’Ordre. Président de l’époque, Bernard Hoerni freine des quatre fers pour modifier le code de déontologie. Le 1er mars en pleine grève, il signe avec l’État et la Cnamts un protocole d’accord sur les gardes de nuit et le week-end. Trahison ! Sept membres du bureau démissionneront en avril. Fin mai, c’est le président et son secrétaire général Pierre Haehnel qui font leurs valises…
Au-delà des gardes, le mouvement traduit une exaspération plus générale. « Dans les réunions, les deux-tiers des généralistes étaient présents et le ton montait rapidement, c’était un peu le défouloir. Ces médecins qui avaient la tête dans le guidon en permanence, qui n’étaient que dans le subir, cela leur a permis de relever la tête. Il y a eu une prise de conscience », se souvient Luc Duquesnel. Rapidement, la fin de l’obligation des gardes n’est plus la seule revendication des généralistes et d’autres mots d’ordre viennent s’y greffer : comme la consultation à 20 euros.
Cet effet boule de neige et la multiplication des revendications feront trainer le mouvement en longueur. On est aussi en pleine campagne présidentielle et il faudra un changement de majorité et de ministre (d’Elisabeth Guigou à Jean-François Mattéi), pour que le mouvement trouve une première résolution en juin 2002. Les médecins obtiendront gain de cause au niveau tarifaire et sur les gardes et les revalorisations de la PDS suivront. Pour Luc Duquesnel, « cette grève reste un mouvement exemplaire pour les médecins dans la forme. Et ce qu’on a obtenu a aussi changé radicalement les conditions d’exercice et de vie des médecins ».
Les dates clés
› 2003. Modification du code de déontologie.
› 2005. Revalorisation de la permanence de soins.
› 2011. les ARS pilotent le dispositif .

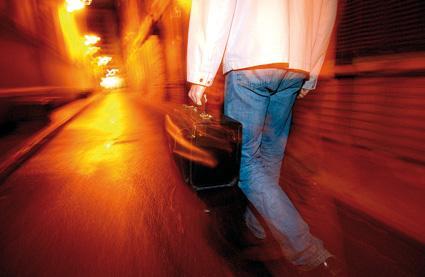
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature