Dans son rapport annuel sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations au sujet de la télémédecine*, pratique jugée « embryonnaire » en raison de l'action « fragmentaire, désordonnée et velléitaire » des pouvoirs publics.
La politique d'expérimentations « inabouties » lancée par les précédents gouvernements est qualifiée d'« échec ». Les sages rappellent les premières « initiatives régionales multiples et imparfaitement suivies, organisées principalement autour des établissements de santé ». Ces expérimentations ont souffert d'emblée de plusieurs faiblesses, selon le rapport : la dépendance à l’égard de l’investissement des médecins porteurs de projet ; l’hétérogénéité des périmètres et niveaux de soutien ; et le caractère non pérenne du soutien du FIR (fonds d'investissement régional).
Périmètre étroit
Plus récemment (à partir de 2014), les nouvelles expérimentations dites « ETAPES » orientées vers la médecine de ville ont également « connu de nombreuses difficultés » (cahiers des charges tardifs, ciblage incertaine entre des actes génériques et des pathologies précises, modèle tarifaire ).
En définitive, la télémédecine connaît en France « un développement extrêmement limité », synthétise la Cour. Et si les quatre actes récemment inscrits à la nomenclature (télédialyse péritonéale, dépistage de la rétinopathie diabétique, téléconsultation en urgence en EHPAD et télé-expertise dossier traitant en EHPAD) élargissent les possibilités d'essor de la télémédecine, ils couvrent un « périmètre encore étroit » de situations, regrette le rapport.
Pourtant, les « sages » voient dans la télémédecine un levier « potentiellement majeur » de modernisation du système de santé. La mise en place d'une « stratégie d'ensemble cohérente » de déploiement nécessiterait de fixer aux acteurs des objectifs « précis et mesurables », en particulier en matière de télésurveillance des pathologies chroniques, peut-on lire. Il conviendrait aussi de « lever les préalables juridiques et techniques à l’essor de la télémédecine ».
Pour la Cour, la généralisation « à court terme » d'un DMP « alimenté de manière exhaustive et en temps réel » est une des conditions de la réussite de cette pratique. Mais surtout, la tarification des actes de télémédecine doit être généralisée selon un « modèle de rémunération de droit commun », tant pour les professionnels libéraux que pour les établissements de santé.
*La télémédecine recouvre cinq types d’actes : la téléconsultation (consultation à distance d’un médecin), la télé-expertise (sollicitation à distance de l’avis d’un autre médecin), la télésurveillance (surveillance médicale et interprétation des données du suivi médical du patient à distance), la téléassistance (assistance à distance d’un médecin à un autre professionnel de santé pendant la réalisation d’un acte), ainsi que la réponse apportée dans le cadre de la régulation médicale des appels au SAMU.

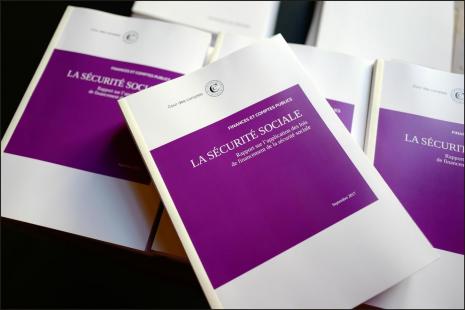
Accès aux soins : la Défenseure des droits entend démonter les discriminations envers les trans
Le Dr Ugo Ricci, généticien criminologue, passionne l’Italie
À l’étranger, des médecins plutôt favorables à l’aide à mourir pour eux-mêmes
749 incidents de cybersécurité déclarés dans les établissements de santé en 2024, en hausse de 29 %